Silvia Härri
Journal de l’oubli
Roman
![]()
B E R N A R D C A M P I C H E E D I T E U R
CET OUVRAGE A BÉNÉFICIÉ D’AIDES À LA PUBLICATION
AVEC LE SOUTIEN DE

LA PUBLICATION DE CET OUVRAGE A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DE LA FONDATION LEENAARDS
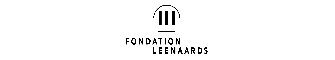
« JOURNAL DE L’OUBLI », QUATRE CENT VINGTIÈME OUVRAGE
PUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR,
A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION DE JANINE GOUMAZ ET DE DANIELA SPRING
MISE EN PAGES : BERNARD CAMPICHE
IMAGE DE COUVERTURE : © ARIANE BLANC-QUENON, BAULMES PAPILLON DE NUIT, ENCRE, 2015, 32 X 32 CM, DÉTAIL PHOTOGRAPHIE DE L’AUTEURE : © SOPHIE KANDAOUROFF, CHÂTEAU DE LAVIGNY, DÉTAIL, 2018
PHOTOGRAVURE : CÉDRIC LAUBER, L-X-IR IMAGES, PRILLY IMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE LA SOURCE D’OR,
À RIOM
(OUVRAGE IMPRIMÉ EN FRANCE)
ISBN 978-2-88241-458-8 TOUS DROITS RÉSERVÉS
© 2020 BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR GRAND-RUE 26 – CH-1350 ORBE
WWW. CAMPICHE. CH
À Vanda
SOLEIL DE MINUIT
(…) griffonner des phrases – dussent-elles n’être lues par personne – m’apporte le même réconfort que la prière au croyant : par le langage, je dépasse le particulier, je communie avec toute l’humanité.
SIMONE DE BEAUVOIR
Tout compte fait
I
(23 novembre 2014)
Je déteste les petits pois.
Je me suis réveillée tôt ce matin, avec cette pensée glis- sée là par erreur dans une brèche de mon cerveau.
Je déteste les petits pois.
Cela ne tient qu’en cinq mots, impossible pourtant de m’en débarrasser, cela s’enracine toujours plus. Je déraille. Je ferais mieux de retoucher l’épisode des retrouvailles de Sami et Paloma, la scène est mièvre, alors qu’elle devrait être la clef de voûte de mon roman. Ou alors dresser la liste des courses pour la journée, arroser mon orchidée, prendre rendez-vous chez le dentiste, au moins, c’est utile. Mais je déteste les petits pois. Je les ai toujours détestés.
Un souvenir insiste : celui de ma mère qui me demande de les écosser. Cela n’en finit jamais, ça file entre les doigts, ces satanées billes vertes, mes mains n’y sont pas bonnes, je me faufile hors de la cuisine dès qu’elle a le dos
— 7 —
tourné. Je grimpe dans le pommier du jardin, m’adosse à son écorce, me retire de la vue des autres pour y lire, blot- tie dans ses ramures.
C’était il y a longtemps, quand mes cheveux n’avaient pas encore la couleur de la cendre froide. Mes premiers pas dans les mots, lus, puis écrits, sont insépa- rables de la rugosité d’un tronc et des pommes blettes tombées à terre.
L’enfance, ça revient toujours. Elle nous poursuit, s’accroche à nos basques jusque dans nos vies d’adultes. Il reste encore beaucoup en moi de la clandestine du pommier à la peau noueuse, de la fillette qui se nourrit de phrases en cachette, ne craignant pas d’échapper aux autres pour les trahir avec un livre.
C’est peut-être grâce aux petits pois de ma mère que je suis devenue écrivain.
(27 novembre 2014)
J’écris pour ne pas m’égarer. J’écris pour ne pas me perdre dans la jungle du monde ou dans mon propre tumulte. Débroussailler les forêts à la machette du langage, marcher dans les sillons des phrases, sonder la page en y dis- posant sa calligraphie pour ne pas être happée par le chaos. Ne pas sombrer.
Ne pas se noyer.
Seule l’encre doit couler.
Autour de moi, on a fini par accepter ce que je fais par érosion, comme on s’accoutume à la lubie d’un proche qui n’a
— 8 —
plus toute sa tête. La plupart considèrent cette activité vaine, subversive peut-être, malsaine sûrement. J’appartiens à la faction de ceux qui sont payés pour passer leur temps à en perdre, à la famille des rêveurs, des intellectuels inutiles.
C’est certain, je fais partie d’une drôle d’espèce. Je m’en aperçois au quotidien, depuis que Gaëlle est venue s’installer à la maison pour être plus proche de la faculté de sciences où elle étudie la biologie marine. Ma petite-fille m’examine comme si j’étais l’un des spécimens qui peuplent ses aquariums.
Ces livres autour de nous, cela la déroute, tout comme le Moleskine que je noircis ou les heures dédiées à pianoter sur mon clavier d’ordinateur. Moi, ce qui m’étonne, c’est de la voir fascinée par la consultation de son iPhone, les pouces fringants, que l’hypertrophie menace, constamment en train d’effleurer l’écran.
Quoi qu’il en soit, chacune tolère l’obsession de l’autre, cette trêve nouée entre générations nous garantit une coexistence plutôt pacifique. J’aime que Gaëlle soit là avec moi.
(6 décembre 2014)
Remontées d’enfance.
Un lapin sans vie, suspendu à un crochet, nu et rose, se vidant de son sang au-dessus d’une écuelle, alors que quelques semaines auparavant il était mon compagnon de jeu. J’allais le nourrir dans les clapiers de notre voisin, je lui avais même donné un nom.
— 9 —
Je n’arrive pas à écarter cette vision d’horreur. Flo- con, au pelage si doux, écorché là, les yeux troués, le jour d’après déposé en morceaux fumants dans nos assiettes. Les parents qui prétendent que ce n’est pas lui, c’en est un autre, acheté au marché. Désormais, je me ferai passer pour malade le jour du lapin. C’est la première superche- rie des adultes dont je me souviens, à laquelle je réponds moi aussi par une supercherie. Nous sommes quittes.
Plusieurs livres de la comtesse de Ségur offerts par ma tante qui affirme d’un ton docte que ces lectures sont édifiantes pour la jeunesse. Il ne me faudra pas longtemps pour comprendre que mon monde ne ressemblera pas à celui de Camille et Madeleine de Fleurville ou de la malheu- reuse Sophie. Je ne suis pas dupe. Ce à quoi je tiens est ailleurs, j’ignore où, ni comment cela adviendra, à dix ou quinze ans, on ne sait pas encore, on pressent seulement.
Ce que je cherchais, les mots me l’ont donné sans que j’aie besoin de faire le tour de la Terre ou de sillonner les mers. La fantaisie reste mon plus beau voyage. Déjà, je confiais mes impressions ou les bribes d’un conte à un cahier quadrillé que je cachais sous mon sommier comme les vieilles leur pécule. Cela ne m’a jamais quittée, l’écri- ture.
Cela ne m’avait jamais quittée. Jusqu’à ces derniers temps.
Jusqu’à Soleil de minuit.
— 10 —
(14 décembre 2014)
Mes mains étaient des ailes, au début. J’avais en tête une histoire, elle me guidait, je la suivais d’instinct et lui emboîtais la plume. Un amour contrarié, dont les deux protagonistes, Sami et Paloma, rêvent de contem- pler ensemble le soleil de minuit. Ils se retrouvent qua- rante ans plus tard sur l’express côtier à destina- tion du Cap Nord. Mon roman doit raconter comment ils finissent par se reconnaître, s’approcher l’un de l’autre, se confier le cours de leur existence. Jusque-là, c’est clair.
C’est l’histoire de Sami et Paloma.
C’est l’histoire d’un ingénieur et d’une danseuse qui étaient amoureux à vingt ans.
C’est l’histoire de deux vieux qui font par hasard le même voyage pour observer un jour qui ne s’éteint jamais.
C’est après que cela s’entortille. Leur destin m’échappe, je n’arrive pas à décider pour eux. Est-il vraisemblable qu’un amour de jeunesse ressuscite au point d’effacer le présent ? Je me demande pourquoi je me suis lancée dans un récit pareil, moi qui n’ai jamais fichu les pieds en Norvège.
Je pense trop, j’écris trop peu et en fouillis. Mes per- sonnages m’étourdissent, ils dansent une sarabande qui me donne la migraine. Ma tête est un manège où Sami, Paloma et tous les autres tournent, tournent, tournent sans s’arrêter, comme dans ces cauchemars d’enfants où le carrousel s’emballe et où l’on hurle au secours, sans que personne ne vienne nous prêter main-forte. Mon petit che- val de bois monte et descend à toute allure, mon petit che- val n’est pas obéissant, il monte et descend, monte et
— 11 —
descend à toute allure, refuse de s’arrêter, à toute allure monte et descend, descend et monte encore encore…
Je cherche la manette qui mettra fin à cette agitation.
(15 décembre 2014)
Mon roman se troue, la trame s’effiloche, mes person- nages s’estompent. Ça ne tient pas, ça ne va pas, ça s’en- fuit. Je m’exaspère.
Ma clairvoyance me fait défaut. Au lieu de parvenir à un seul dénouement, voilà que plusieurs font surface, se ramifient comme des lianes qui s’enchevêtrent, dans les- quelles je finis par m’empêtrer aussi.
Il faudra mettre de l’ordre dans ce labyrinthe.
Il faudra mettre de l’ordre dans mes pensées aussi. Ou acheter une débroussailleuse.
J’évite d’aborder le sujet, surtout avec Maxime, mon nouvel éditeur. Je ne le connais pas assez pour cela. Un jeune homme prometteur mais un peu trop sûr de lui, qui a hérité des éditions quand son oncle Théodore a pris sa retraite.
Théodore, c’est avec tendresse que je pense à lui. J’ai croisé sa route il y a presque cinquante ans, il m’a tou- jours été fidèle, ou alors c’est le contraire, c’est moi qui l’ai toujours été. Je m’accommode de Maxime par loyauté envers son oncle, à qui je dois presque tout. Je ne veux pas abuser de sa confiance.
— 12 —
Dernièrement, il faut admettre que Maxime a ten- dance à s’impatienter. Il a déjà annoncé la parution pro- chaine de Soleil de minuit sur son site et voudrait que j’accélère la cadence. Je réponds sempiternellement la même chose, ça suit son cours, je suis bientôt au bout.
Je m’arrange un peu avec les circonstances. Est-ce déjà à considérer comme un mensonge ? Lui avouer que je m’en- lise, je ne peux tout simplement pas. J’ose seulement l’écrire tout bas dans ce journal. Je ne risque rien, personne ne lira ce carnet dans lequel je consigne tout ce qui me traverse.
(Où donc ai-je posé mes lunettes ?)
— 13 —
II
G AËLLE suspend un instant la lecture du journal de sa grand-mère. Ses joues ont rosi comme
seules rougissent les joues de celles qui ont quelque chose à se reprocher. Se frayer un chemin à travers les feuillets de ce carnet, s’improviser passagère clandestine, il n’y a pas de quoi être fière. Cela ne se fait pas de se glisser dans les pages des autres. Pour sa part, cela la rendrait furibonde que l’on vienne se frotter de si près à sa personne sans la consulter. C’est certain, elle aurait mieux fait de le laisser là où il était et de s’en tenir à la rédaction de son mémoire de biologie marine, elle se sentirait moins coupable.
Pourtant ce carnet laissé là, ça ressemblait à une invitation déguisée. C’est en tout cas ce que Gaëlle a pensé quand elle est tombée dessus il y a à peine une heure.
Elle travaillait à l’ordinateur sur Turritopsis nutricula, une méduse originaire de la mer des Caraïbes, s’escrimant depuis trop longtemps à son goût sur le même paragraphe. Il ne lui paraissait pas trop mal pour le début du chapitre six. Elle
— 14 —
espérait juste ne pas l’avoir garni de trop de fautes d’orthographe. Comment continuer ? Elle ne savait s’il valait mieux enchaîner sur la variation du nombre de tentacules entre les immatures et les adultes ou aborder la transdifférenciation cellulaire. Ce mémoire lui prenait la tête. Un passage obligé, lui serinait-on à tout bout de champ. Alors elle se pliait à cette exigence. Son professeur se vou- lait rassurant, prétendait qu’elle ferait de l’excellent
travail.
À son avis, il rêvait. Faire des recherches, se frotter au terrain, prendre des mesures, formuler des hypothèses, c’était dans ses cordes. Mais expul- ser au minimum cent cinquante pages sur cet ani- mal qui filait encore plus loin chaque fois que Gaëlle croyait l’attraper, pas certain qu’elle en soit capable.
Rester assise des heures durant devant un écran qui se remplissait au compte-gouttes, c’était un vrai supplice. « 22.03.2016, 9 : 07 », indiquait le recoin inférieur droit de l’ordinateur. Ce matin de mars qui se prenait pour novembre tellement il fai- sait gris, on aurait dit que la bestiole avait décidé que l’étudiante ne dépasserait pas la page septante- huit.
Ça s’entêtait, les méduses, elles pouvaient se mon- trer aussi obstinées et rebelles que les humains.
Autour de Gaëlle, la maison se taisait. Sa grand-mère était sortie avec la femme de ménage pour se rendre chez le coiffeur, elles ne rentreraient qu’en fin d’après-midi. Il n’y avait que la jeune femme et cette méduse qui la narguait. Pour
— 15 —
l’oublier, Gaëlle avait gagné la cuisine, s’était pré- paré un café, avait fouillé dans le tiroir à chocolats en quête d’une plaque. Elle avait aperçu la couver- ture bariolée de son miel amandes favori encastrée dans un carnet bleu marine, épais et gondolé, comme s’il avait trop pris l’humidité.
Ce calepin, elle l’aurait reconnu entre mille, c’était celui de Ludmilla. Il n’avait rien à faire là. Ce que sa grand-mère y notait était strictement privé. Personne n’avait le droit d’y fourrer son nez.
Le désir fut pourtant le plus fort ; mieux saisir ce qui se tramait dans la tête de sa grand-mère, se rapprocher de ce qu’elle ne cernait que de l’exté- rieur et par fragments.
(5 janvier 2015)
Une guirlande de Noël défraîchie orne la vitrine du café où je venais souvent me réfugier. Beaucoup moins, depuis quelques semaines. Je n’ai plus tellement envie de sortir.
Aujourd’hui, j’ai fait une exception. Retrouver mes anciennes habitudes me fera certainement du bien. J’aime m’installer sur la banquette de skaï, regarder ce qui se passe autour de moi dans les premières vapeurs du matin, dans le noir d’une ville à peine éveillée.
La serveuse s’approche, elle se déplace comme un auto- mate, je commande un thé noir sans rondelle de citron, elle acquiesce avec un mouvement du menton. Ses cernes lui mangent le visage, elles en racontent beaucoup sur la nuit
— 16 —
qu’elle a passée et toutes celles qui l’ont précédée. Je l’ima- gine déambuler dans un studio en berçant un nourrisson affamé ou en insomniaque cherchant en vain un sommeil capricieux.
Non loin de moi, un homme s’est attablé, dont je ne distingue que le dos. C’est un dos qui n’a pas envie de se tenir droit et se love dans un pullover en cachemire pour prolonger la tiédeur du lit. Le réveil a sonné trop tôt. De ses mains longues et fines, il feuillette un quotidien dont le bruissement se mêle à l’odeur âcre de son café serré. Il pour- rait être pianiste dans un orchestre, s’appellerait Rodolphe ou Alexandre, serait un musicien prodige rongé par la mélancolie, certainement incarné par Marcello Mas- troianni, si son histoire devait être portée à l’écran.
Quand je m’extirpe de ma rêverie, mon pianiste est parti en laissant le journal soigneusement replié, c’est un virtuose méticuleux. Sa table est maintenant occupée par deux étudiantes qui se racontent l’ennui du cours de lin- guistique indo-européenne auquel elles doivent assister en fin de matinée. L’horloge fixée au-dessus du bar marque neuf heures et demie. Cela fait plus de deux heures que je suis là, je ne m’en suis même pas aperçue. Je pose quelques pièces sur la table, adresse un au revoir à la serveuse qui s’affaire autour du percolateur.
Ses cernes, tout comme les mains de l’homme, font désor- mais partie de ma collection de détails encore à peine esquis- sés, ils me serviront sans doute pour un nouveau livre.
— 17 —
(8 janvier 2015)
D’après ce que Maxime vient de m’apprendre, il sem- blerait que je sois en lice pour un prix littéraire. Il s’est exclamé, Ludmilla, c’est magnifique, non? Cela faisait quand même plusieurs mois que je n’avais pas d’actualité, ça allait faire grimper les ventes.
Bien sûr, la nouvelle me flatte. Elle éveille cependant ma perplexité. Comment peut-on juger que telle plume vaut de l’or, décréter qu’une trajectoire artistique est plus significative qu’une autre ? Est-ce la qualité du style que l’on couronne, l’originalité du contenu, la photogénie de l’auteur sur la quatrième de couverture ?
Ma sélection me réjouit tout de même, malgré mes appréhensions. J’y ai peut-être gagné ma place parce qu’il fallait une vieille parmi les candidats, il en faut tou- jours une pour respecter les principes du politiquement correct.
Espérons que je me trompe.
La dernière fois que l’on m’a octroyé une récompense, c’était il y a quatre ou cinq ans, je crois. Je me rappelle qu’un journaliste m’avait même conviée à son émission de télévision. La maquilleuse qui nous repoudre le nez une minute avant le début du direct, le trac qui monte, les caméras braquées sur les invités. Le débat sur mon ouvrage et celui des autres écrivains qui participaient à l’événe- ment, ce fourmillement d’idées, ces passerelles tendues entre un livre et un autre, c’était enivrant.
D’après les retours de mes proches, je me suis mon- trée brillante dans mes propos, amusante, perspicace.
— 18 —
Aujourd’hui, revivre la même expérience me semblerait tout à fait embarrassant. J’aurais peur de raconter des bêtises et de ne pas savoir rebondir dans la discussion.
Avec le temps qui passe, je m’ensauvage.
(18 janvier 2015)
Ne pas oublier que le Cap Nord (71° 10’N), situé sur l’île de Mageroya, constitue la limite entre la mer de Norvège et la mer de Barents, qui tire son nom de celui d’un navigateur néerlandais. Il s’agit d’une falaise de trois cent sept mètres à pic sur l’eau. C’est un lieu mythique où les héros de mon roman vont se confronter à un choix. Le soleil de minuit s’y produit entre le 13 mai et le 29 juillet, me précise un site d’astronomie que je consulte pour me documenter.
(Mais où donc ai-je encore pu poser mes lunettes ?) Message audio de Gaëlle.
Elle articule si mal que je dois l’écouter trois fois pour en
comprendre la teneur. Une invitation à revoir Le Grand Bleu, je crois, à moins que ce ne soit Vingt mille lieues sous les mers, je n’ai pas bien compris le titre. Je n’en meurs pas d’envie, mais je ferais n’importe quoi pour lui faire plaisir. Elle aime tant les grands fonds et le vent du large. Chaque fois que nous parlons de l’Océan ou de ma maison de Noirmoutier, l’enfance s’allume dans son regard.
— 19 —
Je la rappelle pour lui dire que c’est d’accord, m’entretiens avec son répondeur, mes lunettes – que j’ai retrouvées sous une pile de feuilles – bien calées sur la bosse de mon nez.
(22 janvier 2015)
Que Conceçao vienne faire le ménage, cela ne m’a jamais dérangée. J’aime son accent venu d’ailleurs, son bon sens enraciné dans la terre, le froncement soupçonneux de ses sourcils quand elle passe son doigt sur le bois d’un meuble et qu’elle y trouve de la poussière. Elle manie le plumeau et le fer à repasser avec une dextérité qui me déconcerte, parle aux plantes comme personne, récure un sol plus vite que l’éclair, fait preuve d’une patience infinie pour apprivoiser le désordre de la maison, sans toutefois la transformer en un sanctuaire du rangement. Elle a cette finesse d’esprit-là, Conceçao. Cela n’est pas donné à tous.
Aujourd’hui sa présence, bien que discrète, me gêne. Je n’arrive pas à me concentrer, me sentant épiée, continuelle- ment happée loin du livre que j’écris. Que j’essaie d’écrire, devrais-je dire.
Elle me murmure, ça va, Madame Ludmilla? Ne vous inquiétez pas, je vais faire tout doucement. Elle pose son index sur ses lèvres. Je la remercie, je donne des réponses plus qu’évasives, lui répétant de ne pas se faire de souci à cause de l’aspirateur.
De toute façon, elle le sait, quand je travaille, rien ne peut m’atteindre.
De toute façon, je le sais, je fais semblant.
— 20 —
Sur les bancs de ma classe, déjà, je faisais semblant. L’école ne m’a jamais beaucoup intéressée, je la préférais buissonnière. J’apprenais à m’éclipser quand le sujet du cours était trop ennuyeux. Saisir l’instant où je devais manifester ma présence et celui où je pouvais m’absenter, continuant à fixer intensément la bouche du professeur. Je traversais une forêt émeraude, conversais avec un ours polaire sur la banquise, parcourais le monde en mont- golfière comme Philéas Fogg. Un coup de coude de Paul, mon voisin de pupitre, me rappelait à l’ordre si mon vaga- bondage m’avait entraînée trop loin.
Maintenant, le coude de Paul qui se fiche dans mes côtes n’existe plus. Je reste seule avec mes divagations, mes atermoiements, mes distractions. Je ne suis pas très fière de moi, je ne parviens pas à rassembler mes idées plus de trois secondes.
(24 janvier 2015)
Bientôt l’anniversaire de Gaëlle. Vingt-trois ans, déjà. J’ai en tête le cadeau que je vais lui offrir. Une écharpe verte en angora qui m’a fait signe dans une vitrine du boulevard, elle a exactement la même couleur que ses yeux et mettra en valeur ses boucles rousses. Je vais peut-être aussi lui acheter un livre, pourquoi pas ? Un vrai livre, en papier j’entends, dont on peut tourner les pages, pas un fantôme virtuel apparaissant sur un laptop. Je confesse que j’ai peine à saisir cette connexion per- manente avec l’univers, cette nécessité d’être en réseau en tout temps, en tout lieu et en n’importe quelle compagnie,
— 21 —
en contact avec des informations de nature diverse qui s’agitent dans une nébuleuse où l’homme n’est plus apte à estimer ce qui apparaît secondaire de ce qui est primordial. Favoriser le morcellement et la dispersion en nous jetant à la figure quelques fragments de réalité, je suppose que cela a du bon. Cela évite à l’être humain de penser trop dense, de creuser trop profond. En somme, c’est un excellent moyen de manipuler les esprits pour les réduire à l’hébétude.
Mais je m’égare. Ludmilla, cesse de te poser toutes ces questions, reviens un instant au concret ! Arrête de rêvas- ser, va ranger ta chambre, fais tes devoirs, n’oublie pas de te donner un coup de peigne avant de sortir ! Tu as tou- jours la tête ailleurs, me soufflerait ma mère. Il n’est pas bon de trop rêver, donc :
racheter prosecco, cacahuètes et choco, (noir + miel amandes) rendez-vous coiffeur
vérification niveau huile de la Clio, demander à Vincent rappeler animateur radio (?) pour fixer date passage émission
vitamines pharmacie (pour la concentration) commander seconde paire de lunettes
bonnet vert + livre pour Gaëlle
Revenir à cette « réalité » si particulière qui était la mienne, subtilement définie par Virginia Woolf.
«Que signifie “réalité”? Apparemment quelque chose de très erratique, de très peu fiable – qu’on peut trouver ici sur une route poussiéreuse, là sur un bout de journal dans la rue, ou dans une jonquille sous le soleil (…). Mais ce qu’elle touche,
— 22 —
elle le fixe et le rend permanent. C’est ce qui reste quand la peau du jour a été jetée à la haie ; c’est ce qui reste du temps passé et de nos amours et de nos haines. L’écrivain, je crois, a la chance de vivre plus que d’autres en présence de cette réalité. C’est son travail de la trouver, de la collecter et de la commu- niquer aux autres gens ». 1
À défaut de créer, on peut au moins se laisser enchan- ter par l’acuité et la sensibilité des autres.
— 23 —
III
S OUS LES DOIGTS de Gaëlle, la couverture du carnet esquisse un dédale de rides. Boucles, spi-
rales, vagues qui l’attirent loin, puis la ramènent sur le rivage. Le livre de sa grand-mère pour son anniversaire, c’est La Vie devant soi, de Romain Gary. Elle a attendu longtemps avant de l’ouvrir. Ludmilla a dit que c’était un roman qu’on ne quitte jamais vraiment, il fait toujours bon y revenir.
C’est pour cela qu’elle le lui a offert. En même temps que l’écharpe verte.
Gaëlle préfère les images ou la vidéo, tout ce qui va vite et donne une impression de mouvement. Un selfie, par exemple, elle trouve ça tellement plus facile pour montrer ce qu’elle fait, où elle est et avec qui. En un instant, tu as tout.
La lecture, au contraire, c’est lent, poussif, sou- vent fatigant. Ce qu’elle a dû ingurgiter pour pas- ser le baccalauréat éveille des souvenirs plus que mitigés. Des textes écrits dans une langue pleine de poussière et de toiles d’araignée. Bien sûr, elle ne l’a jamais avoué à sa grand-mère, elle ne veut surtout pas lui faire de peine. Il n’y a qu’à se promener dans
— 24 —
son appartement croulant sous les étagères et les bibliothèques pour comprendre.
Ludmilla n’a de place que pour ses livres et sa petite-fille, on dirait. D’ailleurs, quand elle n’écrit pas, c’est qu’elle lit. Sa vie s’est toujours résumée à ce geste qui part de la main, trace des signes ou tourne des pages, une hésitation entre un gratte- ment de plume et un bruissement de papier.
(30 janvier 2015)
Mais ce livre, Ludmilla, il faut lui trouver une fin. Sa fin. Ça n’est pas si compliqué, bon sang, l’affaire de quelques pages tout au plus. Tu l’as fait tant d’autres fois. C’était simple et doux, comme l’eau qui file entre les doigts. C’était même la phase que tu préférais, les der- nières foulées avant de toucher au but, l’euphorie des der- niers mètres.
Cela devait le rester. Cela devrait le rester. Toujours.
(2 février 2015)
Ma tasse préférée est en céramique peinte de blanc, son rebord supérieur est ourlé d’un liseré marron qui s’étire jusqu’à l’anse. Elle est douce au toucher. Sur son ventre se
— 25 —
dessine un oiseau bleu qui surveille son nid. Des centaines de fois j’ai trempé mes lèvres dans le thé ou le café, il est là, fidèle, l’oiseau aux rémiges outremer. Il a beaucoup pépié à mes oreilles, dernièrement il se fait discret. Du moins, je ne l’entends plus. Est-ce lui qui devient muet, fatigué de ne jamais prendre son essor, ou moi qui deviens sourde à son chant ?
(5 février 2015)
Il neige. L’ordinateur portable est ouvert. Un geste d’invitation, ce clavier qui n’attend que mes doigts, eux qui savaient courir sur les touches aussi vite que mes pen- sées. Pourtant je le considère à peine, cela doit bien faire une heure (ou deux ou trois ou quatre ?) que je regarde les flocons traverser le ciel opaque de ma vitre.
C’est si rare, la neige en ville, comme un impromptu ou un haïku. Cela me rappelle ces vers de Soseki, que je me suis empressée d’aller relire :
Le froid le froid – l’eau bleuit
le ciel se rétrécit 2
(Aujourd’hui, n’avoir été que cette femme qui regarde la neige et a oublié son rendez-vous chez le coiffeur, lui a- t-on fait remarquer sur un ton d’imperceptible reproche. Autrefois, j’étais capable d’oublier un rendez-vous parce que j’étais en train d’écrire. Aujourd’hui, j’oublie les rendez-vous parce que je n’écris pas. J’ai les doigts gourds
— 26 —
et la main malhabile, le blanc vaporeux qui tombe à la fenêtre tombe aussi sur ma page. J’ai même la naïveté de trouver cela beau.)
Gaëlle me rejoint, colle son nez contre la fenêtre, s’amuse à faire des ronds de buée. Elle soupire, elle en a ras le bol de son mémoire de master. Elle est en rade à la fin du chapitre un. Doit-elle insérer la référence à l’étude de Piraino, examiner plus en profondeur l’habitat de son invertébré aquatique primitif, évoquer les différents stades de son cycle vital ? Elle est complètement perdue.
Pour la réconforter, je lui assure :
Tu verras, ça va aller de mieux en mieux, ce sont les débuts qui sont difficiles. Et puis tu as choisi un sujet intéressant, non?
Elle me dévisage, tiraillée entre agacement et amusement.
Parce que tu t’y connais en méduses, maintenant ?
Pas du tout, mais la tienne porte un si beau nom, tu ne trouves pas ?
Turritopsis nutricula, tu trouves ça joli ?
Absolument. Ça ressemble à une formule magique à prononcer pour transformer une mouche en ogre ou une mandragore en loup-garou. Penses-y la prochaine fois que tu planches dessus.
Je lui ai fredonné avec un peu de malice, comme dans une chanson de Brel :
nutricula nutriculam nutriculae nutriculae nutricula
— 27 —
nutriculae nutriculas nutricularum nutriculis nutriculis
Pour Turritopsis, j’ai passé, je ne me rappelais plus la déclinaison des noms en – is. Mon latin, tout comme moi, a besoin d’être dépoussiéré.
Gaëlle a levé les yeux au ciel, n’a pu s’empêcher de sourire, a riposté que sa mamie était grave dingue. Turri- topsis nutricula n’est rien d’autre qu’une méduse qui va l’enchaîner à un écran d’ordinateur et l’obliger à ne pas décoller son cul de sa chaise pendant des mois.
Je cite.
(8 février 2015)
Ce matin, j’avais rendez-vous avec Delphine pour voir une exposition sur Soulages. J’ai pris le bus dans le mauvais sens, me suis retrouvée à l’autre bout de la ville. J’observais un sac de plastique blanc soulevé par le vent sur un trottoir. Il virevoltait, dansait au milieu des feuilles mortes et de la poussière avec une grâce diaphane, changeait sans cesse de forme et de trajectoire. C’était si beau, ce ballet. Je n’ai prêté attention à rien d’autre qu’à cela, à ce mouvement éphémère et espiègle. Je suis montée dans le bus sans prendre garde à sa direction.
Delphine rongeait son frein devant les portes du musée. Elle savait que ce n’était pas dans mes habitudes
— 28 —
d’arriver en retard. Elle a cependant paru perplexe quand je lui ai expliqué que la raison en était un sac plastique. À mon avis, elle manque d’esprit poétique.
Nous sommes entrées dans la première salle du musée, où se dressaient plusieurs toiles monumentales de Soulages. Toutes peintes en noir, entaillées à certains endroits, striées de sillons en d’autres, alternant entre surfaces lisses et rugueuses. Je me suis arrêtée devant l’une d’entre elles, je ne pouvais plus la quitter. Elle m’appelait, me contenait presque. Ce noir n’était qu’apparence, il recelait des nuances de couleurs et produisait de la lumière. Oui, ce noir était plus lumineux qu’un soleil, il me réchauffait et m’apaisait. J’aurais aimé y rester pour toujours.
Delphine a continué de son côté, m’a forcée à la suivre à la cafétéria du musée lorsqu’elle a terminé la visite. J’étais demeurée suffisamment longtemps devant mon Outrenoir, on pouvait quand même prendre le temps de s’asseoir pour bavarder un peu. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vues.
Mon amie avait l’air préoccupée pour moi. Elle me trouvait différente, enfin, pas comme d’habitude. Je sem- blais fatiguée et amaigrie. Je devrais peut-être consulter un médecin. À nos âges, il fallait rester vigilantes. Elle a insisté pour me raccompagner chez moi en voiture. J’ai accepté davantage pour lui faire plaisir que parce que j’en avais envie.
Je n’ai toujours pas compris ce qui la tracassait.
— 29 —
(11 février 2015)
Sami et Paloma contemplent leur soleil de minuit en silence, sur le promontoire hostile où se rejoignent les deux mers. Leur rêve de jeunesse est devenu réalité. Le mari de Paloma ne soupçonne rien. Sa femme tient discrètement la main de Sami au milieu des touristes disséminés autour du globe terrestre de bronze qui signale qu’ils sont arri- vés au Cap Nord. Une pancarte bleue aux lettres blanches le précise également. Immergés dans le jour polaire, ils ne veulent plus en sortir. Ils goûtent au gron- dement des flots en contrebas, aux cris des sternes arc- tiques et songent ensemble aux aurores boréales. Peut-être qu’ils verront des phoques ou un marsouin. La lumière qui les enveloppe est si ouatée que je ne les distingue bien- tôt plus.
Je crois que je les perds.
Reçu un message de Gaëlle.
Elle m’avertit qu’elle passera la nuit chez Matteo.
Icône d’un soleil souriant, à défaut de syntaxe maîtrisée, en succédané de présence.
Gaëlle, ses vingt et un ans, ses envies d’indépendance. Ses coups de gueule face à l’injustice, sa façon de rougir quand elle est mal à l’aise, le mépris qu’elle affiche pour ce qui est mondain, son rire virevoltant quand elle me voit pester à cause d’un coup de vent qui a fait s’envoler les pages de mon dernier manuscrit – que je n’ai évidemment pas numérotées – parce que j’ai laissé la fenêtre grande ouverte.
— 30 —
Elle n’a peur de rien, ou presque. C’est une passionnée de moto et de plongée, dont les idoles sont Florence Arthaud et le commandant Cousteau. Elle aime aussi l’escalade et le couscous, passerait des heures à écouter Muse, Stromae et Camille, rêve de traverser l’Atlantique en voilier et déteste le rouge à lèvres.
(Comme elle me manque, ma Gaëlle, en ce soir d’hiver qui dure.)
Trop de crachin dans les yeux, ça lui brouille la vue. Gaëlle est obligée de s’arrêter. Sa grand-mère la connaît beaucoup mieux qu’elle ne le croyait, l’aime encore plus fort qu’elle ne l’imaginait. Elle voudrait rire comme avant avec Turritopsis nutricula, faire une capture d’écran, les maintenir suspendues à l’image arrêtée de leurs meilleurs moments.
Elle allonge la main vers la plaque de chocolat dont elle a déjà avalé la moitié sans même s’en aper- cevoir, en reprend deux carreaux qu’elle laisse fondre sur sa langue, allume l’abat-jour sur la table de noyer. Dehors, le gris a tout envahi.
Elle pense à Ludmilla au salon de coiffure, se demande si sa grand-mère ne se mettra pas à pro- tester quand la coiffeuse voudra passer la laque dans ses cheveux. Quand elle aura terminé la lecture, promis, elle ira remettre le carnet à sa place. Et si Ludmilla le cherche, elle lui dira où il est.
Le cahier marine l’appelle à nouveau au large de ses pages où s’étale l’écriture de Ludmilla, ronde et régulière, en lié, tout le contraire des pattes de
— 31 —
mouche de sa petite-fille, calligraphie d’une autre époque, elle l’emporte dans ses rouleaux.
— 32 —