Nadine Richon
Un garçon rencontre une fille
Roman
![]()
B E R N A R D C A M P I C H E E D I T E U R
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LAUSANNE
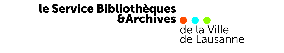
AVEC LE SOUTIEN DE L’ÉTAT DE VAUD
![]()
«UN GARÇON RENCONTRE UNE FILLE »,
QUATRE CENT VINGT-QUATRIÈME OUVRAGE PUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR
A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION DE JANINE GOUMAZ ET DE DANIELA SPRING
COUVERTURE ET MISE EN PAGES : BERNARD CAMPICHE PHOTO DE COUVERTURE : PHOTO DE © DMITRIY BILOUS. ARMS OF MAN AND WOMAN REACHING FROM HEDGES. TETRA IMAGES / VIA GETTY IMAGES. DÉTAIL.
PHOTOGRAPHIE DE L’AUTEUR : © PHILIPPE PACHE, LAUSANNE,
DÉTAIL, 2020
PHOTOGRAVURE : CÉDRIC LAUBER, L-X-IR IMAGES, PRILLY IMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE LA SOURCE D’OR, RIOM (OUVRAGE IMPRIMÉ EN FRANCE)
ISBN 978-2-88241-462-5 TOUS DROITS RÉSERVÉS
© 2020 BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR GRAND-RUE 26 – CH-1350 ORBE
Sophie allonge le pas, elle caracole, s’attelle à sa tâche, affûte sa gestuelle, fracasse son chrono d’athlète, s’attache à son amulette, elle afflue, amasse, advient, elle s’amène, attend son heure, jamais ne s’avoue vaincue, elle a la gagne, force l’admiration, rayonne, la rumeur l’attend, l’accompagne. Beau garçon caméléon, Kamel s’enfonce dans son cocon, se détache du paysage, lâche ses rouages, plonge au fond, lourd, pas méchant, à fond sur le toboggan, il glisse hors-champ, s’éponge sur le tableau, sort du rang, abandonne son camp, on le perd, il tournoie, se détourne, se ronge, se rend à la sombre évidence du moment.
Venu de l’anglais, le mot a enjambé la haie du français et, malgré sa pesanteur, sa laideur, il faut l’évoquer une fois, ce terme poussif qui prétend désigner des femmes panthères, arrachées au sol dans l’espoir de toucher le septième ciel, un record, un podium, une médaille. À la rubrique sportive, Sophie incarne parmi d’autres courageuses du monde entier cette figure de « hurdleuse » : voilà, le mot lâché ne le sera plus ! Encore quelques jours et
— 3 —
notre héroïne pourra décrocher le titre de championne d’Europe dans cette discipline, la course de haies, un peu plus de septante-six centimètres de hauteur à franchir dix fois sans fléchir. La jeune Française a brillé en salle cet hiver et croit pouvoir survoler ces quatre cents mètres en cinquante-quatre secondes. Elle le sait, le répète, j’en suis capable. Berlin sera son heure. Celle des femmes a sonné en 1984, à Los Angeles, où la première médaillée d’or sur cette discipline portait haut les couleurs du Maroc et son nom va être cité, Nawal El Moutawakel. Les sauteurs masculins s’expriment librement depuis les Jeux olympiques de Paris en 1900, faut-il le préciser ?
Kamel, lui, s’envole uniquement dans sa tête. Né en France, il regarde ailleurs sous le coup d’un échec scolaire lourd à porter ; il s’égare dans la mémoire de ses ancêtres marquée par les violences coloniales en Algérie, les manquements de l’empire français consumé et déplacé vers le projet européen, l’indépendance au prix d’une sanglante lutte armée, puis la guerre civile atroce dont ses parents lui ont parlé, jusqu’au soulèvement populaire actuel qu’il regarde sans comprendre, toutes ces jeunes femmes le poing levé, chevelure sombre étalée sur leurs épaules, et lui au point mort. Il a grandi à Paris dans le confort propre à sa génération, juste avant qu’une partie de la conscience mondiale ne bascule dans l’inquiétude environnementale. Contraire- ment à Sophie, il n’a pas trouvé à se réaliser dans l’épopée individuelle et il peine tandis qu’elle ramène le genou, garde le tempo et parvient à décoller au moment propice sans percuter la haie.
— 4 —
Le garçon succombe aux fausses promesses d’un écran qui ne lui renvoie aucune image de lui-même. Il ne se reconnaît ni dans le timing révolutionnaire algérien ni dans le modèle macronien de la réussite. Méfiant envers ceux de ses amis qui rêvent de s’enrichir en balançant des idioties sur le Net et les quelques jeunes, non moins déterminés, qui s’engagent en faveur de la planète, il cherche une utopie originale qui parle à son cerveau perturbé. Il ne se sent ni bien ni véritablement mal, il flotte dans une bulle d’insensibilité, étranger au bonheur comme à la douleur…
Les larmes de Sophie ne lui font pas perdre pied. Inlassablement, elle projette son corps par- dessus les dispositifs érigés, éveillant au passage leur petit son métallique ; elle cherche la perfor- mance au bout du clic dix fois répété et s’écrase en fin de parcours contre un mur matelassé, puis elle recommence. Les larmes de Kamel ont séché depuis longtemps sur son beau visage mal rasé, où s’attarde malgré lui sa douceur de postadolescent angoissé à l’idée de la vie qui s’annonce sans garantie ni programme déterminé. Il rêve de quitter ses parents-poules et de se jeter dans la nature comme un jaguar mais les responsabilités associées à la liberté lui font peur. Il ne croit plus aux ensei- gnants, aux patrons, ni même à la volonté farouche de sa mère, il voit la France comme un monde clos où l’école, le travail et les gagnants du jour lui résistent, il a parfois l’impression de se prendre le pays entier dans la figure. Est-ce vrai ou construit par la critique sociale qui s’extrémise face à la poussée des inégalités ? Nous avons ici son ressenti
— 5 —
et nous verrons qu’il fluctue, rien n’est figé dans la tête de ce jeune homme sans qualités, comme si l’espoir brûlait encore à la manière d’une bougie de Noël qui embaume des rêves enfantins pas complè- tement éteints.
L’ennemi de Sophie pouvait émerger non pas du monde extérieur mais du tréfonds d’elle-même ; il s’incarnait sous la forme d’un refus viscé- ral d’enfoncer un talon au sol pour amener la jambe opposée à se déployer, le pied pointé vers l’obstacle, un bras tendu loin derrière et l’autre désignant l’horizon victorieux. Aujourd’hui, elle maîtrise mieux cette angoisse qui l’étreignait aux premiers temps de son entraînement et, dans sa recherche de la perfection, elle s’appuie davantage sur son entourage. Suspendu au fil doré de son enfance évaporée, Kamel n’a pas atteint le point de non-retour mais la roue tourne, l’âge avance. Il a eu vingt-trois ans en mars et paraît plus jeune avec son regard intense ourlé de longs cils noirs ; ses parents se désolent de ne lui voir qu’un seul atout pour l’heure, cette beauté féline qui va forcément s’ef- friter. Sophie fêtera son vingt-cinquième anniver- saire en juin et rien ne vient inquiéter son père et sa mère, qui poursuivent l’un et l’autre des activités multiples et des ambitions personnelles fort éloi- gnées de la notion de famille traditionnelle. Kamel et Sophie ne se connaissent pas mais habitent presque le même quartier, lui avec ses parents dans une rue banale aux immeubles massifs, à mi- chemin entre les stations de métro Oberkampf et République, elle avec son père dans un apparte- ment aux boiseries apparentes niché au fond d’une
— 6 —
cour pavée à l’abri des voitures et des passants ; Sophie s’absente au gré de ses activités sportives, mais revient toujours à son point de départ pour partager sans le savoir des trottoirs, des boulevards, des couloirs de métro, des cafés, des morceaux de ciel avec Kamel. Se sont-ils regardés brièvement, voire effleurés en passant ? On peut le penser et même le vouloir. Cet écrit qui s’initie sera leur histoire et la vôtre, si vous acceptez d’en tirer encore un peu le fil entre Paris et Alger.
À l’heure où j’écris ces lignes, j’apprends la mort d’un très grand auteur. Je vois venir cette
« Opération Philip Roth » comme si c’était à la mienne qu’un chirurgien allait procéder pour tenter de me rafistoler, alors que je me sens amputée face à un écrivain aussi prodigieux. Mes mains coupées s’égarent sans trace visible au-dessus du clavier tels deux petits fantômes exsangues et effarés. À quoi bon en rajouter ?
— 7 —
LA MALADIE DE KAMEL
Le chenapan cherche un chemin, il déniche ses peluches, détache ses éléphants, ses fennecs, lâche son caniche, arrache ses affiches, se détache du fœtus, sur la roche chemine, s’écorche et se fâche.
Enveloppante comme un duvet de lit, l’odeur mielleuse d’un soda éventé se répand, pensons aussi aux effluves d’une confiture d’abricots ou d’un fondant au chocolat encore chaud. Légèrement écœurant, cet arôme évoque l’esprit enjoué de l’enfance où se mêlent les peurs d’un fils unique plutôt gâté, qui s’éprouve pourtant comme un défavorisé. Kamel traîne au lit, grappille des miettes d’infos sur les réseaux, fait défiler sous son regard somnolent des rues occupées par des manifestants et dévastées par des blacks blocs parasitaires, une inondation sans précédent à Venise, puis le selfie sexy d’une amie qui a grandi, elle aussi… Il est surpris par l’image pourtant banale de cette étudiante joyeuse, peut-être un peu éméchée, qui le saisit entre délectation et réprobation, sans qu’il comprenne très bien ce qui
l’attire et en même temps le dérange ; en revanche, il n’a aucun avis sur la politique, les explications données, quel que soit le parti, c’est juste un spectacle froid pour lui qui retarde dans sa chambre le moment de poser ses deux pieds sur le linoléum bleuté. Ses habits d’hier sont disséminés sur une chaise ou même sur la table où se noient quantité de petits papiers annotés, choses à faire demain, bientôt, quand il pourra. Il dérive sur son lit- radeau, désarmé face aux obligations qui commen- cent à s’accumuler, et se protège d’abord des injonc- tions maternelles qui viennent parfois troubler son sanctuaire pour lui rappeler que le temps passe. Comme s’il ne le savait pas !
Ses études ont pris du retard sous l’effet de la dyslexie, cette disposition du cerveau qui ralentit considérablement la lecture. Si bien ajustés pour les autres – ces chanceux – les mots s’offrent à lui en pagaille. Déchiffrer un paragraphe reste une simple victoire d’étape, un maillot à pois qu’il faut retirer, aussitôt enfilé, car la suite ne semble pas connectée aux lignes à peine lues. Comme un cycliste ramené au pied de la même route de montagne, Kamel se voit contraint de relire l’ensemble pour consolider le mur textuel menaçant à tout instant de s’effon- drer. Quand il parle, il aligne des phrases claires au sein desquelles viennent se glisser un ou deux mots déformés qui amusent la galerie ; il en profite pour rire, lui aussi, et cajoler son public familial et amical avec des blagues faciles, parfois géniales et inattendues. Durant sa petite enfance, il pour- suivait des raisonnements dont il appréciait seul les ramifications souterraines ; cet enthousiasme
— 9 —
singulier et souverain pouvait durer aussi long- temps que personne ne lui signifiait la fin des festivités.
La dyslexie n’est pas un long fleuve tranquille, ce serait plutôt un torrent sauvage qui éclabousse les pierres et rebondit à la figure de celui qui s’y baigne à journée faite, faute de mieux. Ce trouble s’abat tel un filet sur les poissons, tisse dans le cerveau sa toile d’araignée comme, chez d’autres malchanceux plus grands encore, un cancer infiltré dans le poumon, étalé dans le foie, au hasard de la génétique. Cette difficulté à lire, et davantage à écrire, accablait ses proches plus que lui-même, alors qu’il était encore peu confronté aux consé- quences sociales de son handicap ; très vite, sa mère en a été profondément affectée car elle anticipait l’adolescence, sachant que d’autres ennuis pour- raient alors se greffer sur cette perturbation première.
En grandissant, le jeune homme s’est plaint d’une solitude de plus en plus marquée, sur fond de moqueries et de lourds défis successifs. Ses difficultés scolaires ont également engendré chez lui une ingénieuse capacité à contourner les écueils de l’écrit et à tenir en sourdine sa propre inquié- tude. Enfouir ce handicap sous la fanfaronnade s’avéra longtemps la meilleure des stratégies. Contrairement à certains dyslexiques, aucune méthode ne put l’aider durablement. Il s’est épuisé à vouloir transmettre sa pensée aux êtres norma- lement constitués, qui ne cessaient de lui rétorquer qu’en toute logique ils ne voyaient pas le lien entre ce qu’il disait vouloir exprimer et la manière
— 10 —
particulière qu’il avait de l’écrire. Ce dialogue de sourds lui arrachait encore des rires, quelquefois, mais était devenu de plus en plus pesant au fil du temps. Pour atteindre un niveau acceptable aux yeux de l’institution scolaire, il avait subi des heures de réécriture laborieuse, aidé de sa mère, là où les autres expédiaient leurs exercices en trente minutes avant de rejoindre ces divins horizons ludiques, toujours retardés pour le simple mortel plombé par cette satanée affliction.
Depuis quelques semaines, il semble avoir décroché : son attitude oscille entre colères subites et longs replis indifférents. Il ne fait plus rien. Rongée par l’anxiété, sa mère imagine de mauvaises fréquentations, la consommation de drogue ou même la petite délinquance ; plus que jamais, elle devait se forcer à l’optimisme, ne pas voir en cette maladie l’expression d’une paresse décomplexée. Kamel peut encore, s’il s’en donne vraiment la peine, décrocher un diplôme qui lui permettra, peut-être, d’acquérir un jour son indépendance. Comme chaque parent confronté au handicap de son enfant, elle imaginait que sa propre mort laisserait le jeune homme désemparé, à la merci d’une aide extérieure pas forcément dispensée. Elle rêvait encore pour lui d’un avenir tout tracé, mais sentait en même temps qu’il fallait y renoncer et le laisser tâtonner en lui accordant sa confiance. Elle se demandait comment l’aider à atteindre une cer- taine autonomie et ne parvenait pas à résoudre la contradiction entre ce souhait et l’encadrement très strict qu’elle se sentait obligée de lui imposer.
— 11 —
JAGUAR QUETZAL
Cheville ouvrière, charge d’âme, Ghita chevauche les heures, chamboule les idées, féminine, féerique, elle fédère au feeling, fait chorus, cherche, féconde, fertilise, festonne, elle chouchoute, chérit, chuchote, chavire sans chuter, abaisse les chicanes, s’effrite, déchante mais tient le choc, charrie sa chevelure, chambarde la charia, désenchante le charlatanisme, chasse ses reliques, enchaîne, se déchaîne, chatoyant phénomène, elle effraye la peur, effectue son labeur, efface les califes, chagrine les Tartuffe, efficace, effective, elle effleure, effeuille les secondes, charge la charrue, charpente, fleure son Chanel, chacun et chacune la chantent.
Dehors le soleil fige le ciel sur une note bleue ou laisse la pluie fouetter les vitres et jouer avec les passants contrariés. À l’intérieur, une constante vague de douleur accueille Ghita quand elle pénètre de son pas d’infirmière dans les chambres alignées le long d’un couloir hospitalier : la mère de Kamel brise cette masse de souffrance avec un sourire avisé en manipulant une aiguille ou un cordon transparent. Elle est arrivée à l’adolescence
— 12 —
en France avec ses parents marocains et s’y est établie pour la vie. Ce soir-là, après une journée de travail qui a filé comme les autres dans l’oubli, elle arrive chez elle épuisée et se réjouit de savourer, seule ou avec son fils, quelques épisodes d’une série télévisée. Kamel l’attend et n’a pas l’air bien disposé, il traîne devant un café refroidi et lui demande de but en blanc pourquoi elle ne porte pas le voile. Comme si elle n’avait pas enregistré la question, elle se lave tranquillement les mains puis ouvre le frigo avant de répliquer d’un ton sans appel :
Parce que je n’en ai pas besoin pour entretenir mon rapport avec le Ciel.
La riposte de Kamel lui paraît stupéfiante et la livre à quelques longues secondes d’incrédulité.
Tu ne crains pas l’ange de la mort ? Pourtant tu devrais, car il viendra te terroriser dans la tombe si tu ne couvres pas tes cheveux maintenant !
« L’intelligent Kamel, mon doux garçon, s’amu- se-t-il vraiment à proférer de telles âneries , s’interroge-t-elle, à l’heure où la combustion des hydrocarºbures produit, chaque jour que Dieu fait, des tonnes de dioxyde de carbone sur cette pauvre planète ? Soudain, tel un glacier ébranlé par la mer réchauffée, le corps de Ghita se penche en avant et, sous l’effet d’un élan souterrain surgi de quelque recoin mental préservé, son rire dévale comme une cascade bouffonne qui fait voltiger les bouclettes autour de sa tête.
Kamel recule au fond de la cuisine et manipule brutalement une étagère mobile pour s’emparer d’un paquet de chips. Ghita se reprend, observe son fils et songe, en considérant son air lugubre,
— 13 —
qu’il voulait peut-être simplement la provoquer, lui qui avait dû traîner toute la journée au lieu d’étudier, et qui s’en faisait le reproche. Elle lui demande de placer les assiettes sur la table, deux seulement, puisque le père de Kamel chante ce soir-là dans un bar, une activité trop peu fréquente pour contribuer véritablement à l’entretien du foyer. Homme séduisant et peu enclin aux cour- bettes, Karim était venu tenter sa chance en France dans le sillage du raï algérien, ce genre musical qui avait traversé la Méditerranée avec les mélodies chaloupées de Cheb Mami et Cheb Khaled, dont les voix ensorceleuses animaient toutes les fêtes réussies au mitan des années 1980. À cette époque, Paris attendait ce style, et Karim n’avait pas suffisamment cherché à innover en puisant à des sources diverses.
La vie, jusqu’ici, n’avait offert qu’un filet de lumière à cet enfant de Mostaganem, au gré d’une poignée de contrats artistiques décrochés entre deux emplois de barman, où il lui arrivait de côtoyer et de servir la crème du show business. Il avait épousé Ghita à Paris, sans jamais connaître la notoriété fallacieuse ou méritée de certains compatriotes nés, eux aussi, au début des années 1970 et dont il convient de citer, parmi les plus médiatisés, Khaled Kelkal, membre du Groupe islamique armé et orchestrateur des attentats commis en France durant l’été 1995, et Kamel Daoud, brillant écrivain-chroniqueur qui n’a de cesse de dénoncer la terreur intégriste et l’hypocrisie religieuse donnant à de pieux refrains des accents diaboliques.
— 14 —
Karim se plaignait rarement de la France : il estimait y vivre mieux qu’en Algérie, où son tempérament rebelle aurait attiré dangereusement l’attention sur lui. Par bonheur, il ne portait pas à fleur de peau l’histoire conflictuelle des deux pays, même si son oncle était mort durant cette guerre qui, peut-être, aurait pu être évitée si la République d’alors avait engagé un processus d’indépendance avant la rupture sanglante amorcée en 1954. Karim se vivait comme un binational affirmé, Européen, Méditerranéen et même citoyen du monde, loin des tourments réels ou politiquement entretenus à l’ombre d’une frontière et d’un passé vitrifié. « Après tout, Ghita m’aime pour cette liberté-là », songeait- il lorsqu’il se sentait malmené par des pensées aux atours défaitistes.
Si attentive à leur fils, laminée par l’inquiétude, Ghita est entrée depuis quelques semaines dans une phase de déprime et Karim le voit, sans vouloir toutefois endosser le rôle de surveillant familial qu’elle voudrait lui confier. À ses yeux de père, Kamel devrait apprendre à vivre seul, au lieu de se cacher comme un éternel petit garçon derrière son trouble neurologique, sous l’effet de la peur ou de la paresse. Il veut penser à son fils en termes de « normalité ». Depuis son enfance de fille unique, Ghita savait décider et agir vite, en effectuant elle-même la plupart des tâches quotidiennes, une tendance qu’elle peinait à refréner pour obliger Kamel à se débrouiller. Avec ce garçon, il faut laisser du temps au temps, estimait-elle, reléguant ses propres inquiétudes au placard dans l’urgence des jours qui se succédaient jusqu’ici sans événement saillant.
— 15 —
Elle s’était documentée au sujet de la dyslexie auprès d’un neuroscientifique rencontré à l’hôpital, mais se refusait à devenir une mère spécialiste, faute de temps et par crainte d’envahir complètement l’univers de son fils. Elle avait compris une chose essentielle qu’elle s’efforçait de transmettre à son entourage : ce trouble de l’apprentissage ne dénote pas un manque d’intelligence. Il s’inscrit dans l’immense chantier des synaptopathies et présente, comme toutes ces maladies du cerveau, un spectre qui va du plus sombre au relativement léger. Sans trop savoir pourquoi, il lui semblait qu’une dose minimale de déni, forme paradoxale d’innocence cultivée, pouvait aider sa famille à aller de l’avant. En outre, elle expérimentait comme infirmière tant de détresses et de désolations qu’elle ne pouvait pas se permettre de laisser s’installer la déprime dans son foyer, ce qui convenait bien à son mari, toujours prompt à plaisanter pour alléger leur vie. La résistance de Ghita, en ce moment, semble dange- reusement ébranlée.
Dans leur modeste appartement, où tout a été choisi avec soin pour ne pas encombrer, même la vaisselle est colorée. Karim a pris la peine depuis leur installation de dénicher des objets à la fois intéressants et peu coûteux, ce qui confère à leur quotidien une allure légère et hors du temps. Ghita achète des fleurs, parfois des bougies parfumées. Leur seule folie se limite à une impressionnante collection de DVD accumulés au fil des ans, un luxe partagé le soir avec leur fils, qui a vu très jeune Gangs of New York, par exemple, et le leur reproche parfois pour rire, en se déclarant encore traumatisé
— 16 —
par ces images de grande violence. Réponse des parents : « Oui mais c’est Martin Scorsese ». Si une œuvre fait réfléchir, elle est bien, parfois indépendamment de son auteur. Farouche ciné- phile, Ghita estime que les films créent des mondes parallèles explorés au singulier par chaque specta- teur. « Et puis alors, s’étonnait-elle, notre époque critique les jambes joyeusement exhibées par des milliards de jeunes filles, comme dans le cinéma de Woody Allen, et félicite les femmes qui dissimu- lent sous des voiles presque toutes les parcelles de leur peau, c’est à n’y rien comprendre ! » Elle-même agrémentait ses tenues simples avec une succession de foulards légers, non pas destinés à emprisonner le crâne et grignoter les joues, mais étalés sur ses épaules pour raviver l’étoffe d’une robe, ou enroulés autour du cou pour se réchauffer.
En de rares occasions, elle retirait de l’armoire sa pièce préférée, un incroyable cadeau reçu d’une femme dont elle avait soigné le mari sans oublier de parler avec lui, presque jusqu’à la fin, des bonheurs du cinéma et de la lecture. Quelques semaines après la mort de cet ancien instituteur, Ghita avait reçu un petit paquet envoyé à son nom au service des soins palliatifs : elle avait découvert, soigneusement plié et emballé dans un papier de soie, un carré Hermès dessiné par l’artiste Alice Shirley et figurant dans un flamboiement de couleurs, de plumes et de fleurs le sommeil d’un félin paisible et grandiose abandonné à ses rêves tachetés de jaune, de vert et de rose, tandis qu’alentour volètent une quinzaine de papillons ignorant la peur. Cette création baptisée « Jaguar Quetzal » avait suscité
— 17 —
chez Kamel, encore enfant, des cris de joie ponctués de rires délicieux et il complimentait sa mère chaque fois qu’elle portait ce foulard.
Kamel aime ses parents et considère Ghita comme son principal soutien dans une existence dont il croit mesurer soudainement toute la tristesse et l’ennui, lui qui a vécu si peu et s’im- patiente chaque jour davantage. « Je suis le jeune le plus malheureux de France », soupire-t-il parfois en guise de provocation réussie puisqu’il se donne l’air d’y croire sérieusement, affalé dans les profondeurs d’un canapé qu’il refuse de quitter malgré les demandes répétées, une attitude que sa mère attribue à ce qu’elle nomme « la maladie de Kamel ». Elle ne sait plus s’il s’agit de la dyslexie, d’une rébellion postadolescente, d’une dépression, ou d’une combinaison des trois. Karim, on l’a vu, pen- che plutôt pour la paresse. Ghita veut convaincre son mari que l’heure est grave et exiger de lui qu’il garde un œil sur les fréquentations de leur garçon, elle ne peut tout de même pas être partout !
Après la réplique de Kamel au sujet du voile, elle s’est mise à soupçonner ceux qu’elle nomme
« les idiots », ces adeptes du Coran au premier degré et d’une vie irréelle au VIIe siècle. Elle avait voulu habiter au cœur de Paris, quitte à loger à trois dans un appartement trop petit, pour fuir l’effet de groupe qu’elle avait connu durant sa prime jeunesse au Maroc. « Le communautarisme héberge parfois le meilleur, mais souvent le pire, surtout pour les femmes », disait-elle. Même sans penser à la tentation terroriste, elle craignait pour Kamel une dérive pseudo-religieuse sur le mode
— 18 —
obsessionnel et séparatiste, alors que le modèle français prône une diversité tempérée par l’inté- gration dans l’unité républicaine.
Entre l’anomie qui pousse de jeunes naufragés à fantasmer une entité blanche en danger, et le lien étouffant au sein d’un prétendu collectif musul- man, cette femme rationnelle et prudente avait cherché le bonheur des siens dans une mixité so- ciale propre à contenir à la fois la mauvaise image de soi et les ardeurs identitaires. « Une piètre auto- estime conduit au désir de se grandir artificiel- lement et de salir les autres », analysait-elle. Le mo- ment lui paraissait venu de secouer Karim en sollicitant de sa part un soutien plus actif auprès de Kamel. « Ils ne pouvaient plus faire l’économie de cette inquiétude », pensait-elle.
Ghita réfléchissait à ces sujets et avait trouvé, tout à fait par hasard, une phrase de Marcel Pagnol à propos de l’oraison funèbre d’Henriette d’Angle- terre, où Bossuet semble très proche d’exprimer l’idée que la vie, si précieuse, ne vaut sans doute pas la peine de commencer, puisqu’elle ne doit pas durer. «Malheureusement, l’amour de la vie a fait naî- tre, grâce à l’usage de l’intelligence, la peur de la mort», écrit Pagnol, et chez un certain nombre d’hommes
« la conclusion que la vie n’avait aucune valeur ». Ghita envisageait maintenant le fossé non seulement entre la France et les islamistes, mais aussi et par- tout dans le monde, entre les êtres pour qui l’amour de la vie est, comme l’exprime Pagnol, « la seule base possible de la civilisation et du progrès » et ceux qui, par bravade et désespoir, anticipent la mort.
— 19 —
CE QUE TU « HAIES »
Le temps s’allonge et prolonge l’attente, Sophie s’étend, s’endort et songe, s’enfonce dans l’oubliance puis tente sa chance, hanches en avant, enjambées longues visant la performance affolante, la conquête foudroyante, puis enfin, une franche délivrance.
Le jour se glisse avec une senteur d’herbe mouillée dans la chambre de Sophie. La pluie s’est éclipsée avec la nuit et la clarté matinale annonce une température clémente qui jettera les Berlinois ravis dans les parcs entourant la Sprée tandis que, sur le stade olympique, la jeune femme ira chercher une victoire printanière sur le quatre cents mètres haies. Parmi ses rivales, une élégante coureuse britannique et une collègue tchèque puissante et prometteuse, mais également une longue athlète ukrainienne qui a percé lors de la demi-finale…
Sophie parcourt ses messageries, WhatsApp, Messenger, commentaires Facebook, SMS, sans rien attendre de spécial sinon un signe de son père qui tarde à lui répondre et qui se trouve entre le Stromboli et la côte sicilienne à bord d’un voilier
— 20 —
avec son amoureuse, tandis que sa mère, qui vit seule à Genève, sélectionne les prétendants sur un site de rencontres ; à cinquante-six ans, madame n’est pas du style à défaire la nuit l’ouvrage tissé le jour en attendant le retour d’Ulysse, elle cherche et trouve des hommes, pas tout à fait le bon jusqu’ici, mais elle y croit et ne montre d’ailleurs aucune impatience. Les parents de Sophie forment un couple amical, non divorcé, habitant encore sous le même toit lorsque la mère vient passer du temps à Paris pour son travail ou voir sa fille. Quand Sophie ne s’entraîne pas en quelques points du globe plus ou moins éloignés et adaptés à son évolution dans la discipline, elle loge chez son père au cinquième étage d’un charmant immeuble de la rue Charlot, dans le Haut-Marais, un vieux quartier populaire à deux pas de tout et en pleine mutation, donc de plus en plus chic en réalité.
Parti de Strasbourg où il vit, le frère trentenaire de « So » (surnom qu’il donne à sa sœur depuis leur enfance) annonce qu’il arrivera en voiture en tout début d’après-midi, lui qui adore conduire, un dada qu’elle ne partage pas, mais dont elle a profité maintes fois dans le confort de l’Audi R8. À cent cinquante kilomètres-heure sur les autoroutes allemandes, le bougre se fait plaisir, même s’il a dû tomber du lit avant l’aube, songe Sophie. Pour des raisons personnelles qui rejoignent les priorités écolo- giques de son temps, elle préfère le train de nuit et prend l’avion uniquement pour survoler la mer. Durant ses rares loisirs, elle adore le vélo sans forcer : elle aime surtout les descentes ! Le temps long de la déambulation, la rêverie solitaire, l’immersion dans la
— 21 —
nature, ce sera pour sa retraite, autrement dit un jour lointain qu’elle peine à imaginer. En ville elle prend le métro, qui lui permet de s’abandonner au moment présent ; le plus souvent elle se plonge, sur sa tablette ou en ouvrage papier, dans un livre dont lui a parlé sa mère, toujours au courant de tout. La jeune athlète vient de dévorer Le Consentement de Vanessa Springora, sur les crimes d’un auteur connu, pédophile notoire drapé dans le récit falsifié de sa vie, après une plongée marathonienne dans Les Furtifs d’Alain Damasio, sept cents pages autopsiant un monde sous haute surveillance, à peine décalé de notre univers hyper- connecté ; un pavé absorbé à petites doses fréquentes, parfois debout parmi les passagers compressés. Sophie apprécie ce genre d’exploit de la part d’un auteur, qui en demande presque autant à ses admirateurs solli- cités par un effort hors du commun.
Aujourd’hui à Berlin, elle devra se contenter pour toute famille de « monsieur frère », déjà, en avoir un ce n’était pas rien, et c’est l’aîné tant aimé, pas le boulet qu’elle aurait pu traîner si elle était mal tombée : quelle chance d’avoir une famille éclatée mais facile à vivre ! Rodolphe s’était spécialisé dans l’organisation d’anniversaires, de mariages, voire d’enterrements hors des sentiers battus. Sophie avait eu un amoureux mais elle se méfiait des unions légales ou même, tout simplement, de la vie à deux. Elle en parlait quel- quefois avec sa meilleure amie, qui comptait pour sa part épouser une femme charmante et brillante, un peu plus âgée et déjà bien engagée dans la vie professionnelle. « Bravo, avait soufflé Sophie, mais moi c’est en solo que je gagne mes courses et ferai
— 22 —
ma vie ». Devant la mine déconfite de son amie, elle lui avait rappelé son histoire douloureuse avec un garçon volage, qui s’était enlisée dans un chagrin d’amour avant même leur séparation. Elle voyait donc le couple comme une équation dangereuse.
« Oui mais c’est un homme », lui avait répondu Tal. Celle-ci était arrivée la veille à Berlin, elle voulait voir Sophie remporter cette course et ne doutait pas d’un tel succès à la pensée de l’existence hors nor- mes de son amie, faite d’acharnement physique et de discipline mentale. Tal n’avait pas grand-chose de sportif elle-même, ne s’intéressait guère à ce genre de compétition, mais admirait la beauté musclée et le courage de Sophie. En outre elle se sentait fière de pouvoir compter sur une cham- pionne d’Europe en guise de témoin de mariage.
La journée berlinoise historique commence à peine et Sophie hésite à se recoucher, ce qu’elle fait finalement après avoir avalé lentement un verre d’eau mêlée à du jus de raisin ; elle médite un instant, concentrée uniquement sur sa respiration, puis mentalise sa course, commence à passer les haies en quatorze foulées, puis en quinze, la vitesse sera la clé du succès, elle le sait, se le répète, soupire, s’étire… «Comme il est bon ce lit et lui, contre moi, qui est-ce ? » Sophie caresse des cheveux d’une douceur d’ange et presse son ventre contre celui de l’inconnu dont le visage reste flou, elle sent les doigts de cet homme autour de ses joues, qu’il comprime délicatement comme s’il tenait un oiseau entre ses mains. Elle perçoit alors son propre corps glissant hors du lit : elle s’envole au plafond. Abandonnée là-haut, elle observe les amants,
— 23 —
admire leurs abdomens gainés, corsetés mais vivants tels des poissons qui s’unissent en une chorégraphie frétillante ; leurs peaux tendues n’abritent aucun secret, nulle menace cellulaire dans les profondeurs de la chair, c’est la santé à l’œil nu, le mouvement à l’état pur, deux ventres assemblés, fouettés, enlacés sur un air de java, deux corps impatients comme des petits rats d’opéra, se joignant et se décollant pour mieux rebondir sens dessus dessous. Sophie regarde et ressent en même temps le poids de l’inconnu, elle lui offre son cou, elle veut sans oser le dire qu’il la dévore à cet endroit précis, qu’il fasse semblant de la clouer dans cette position d’abandon, elle aimerait connaître la puissance et la moiteur de ses lèvres, elle avance ses mains mais ne touche plus rien, comme si l’amant improvisé s’était liquéfié, elle se réveille, franchissant ainsi une ligne d’arrivée sans autre jouissance que le souvenir ambigu d’un songe évaporé.
L’heure est à enfiler la pantoufle de verre, peu importe la matière du moment qu’elle adhère parfai- tement aux pieds de celle qui doit dompter d’ici peu un quatre cents mètres haies. Dans les contes la princesse dort, dîne ou danse, ici elle court pour forcer le happy end, première sur le podium, deuxième, troisième ou chocolat car la compétition reste un univers d’une implacable simplicité. Son frère Rodolphe est arrivé, un soulagement pour Sophie qui craint d’apprendre un jour sa mort sur une route tant il abuse du volant. L’accolade est joyeuse entre la cadette et son aîné, en ce moment tendu qui ouvre de nouvelles perspectives pour la jeune athlète. Ils prennent le temps d’échanger quelques plaisanteries
— 24 —
gamines en forme de talisman : le passé nourrit le présent, le connu masque l’inédit mais déjà Sophie est prise, véhiculée, cousue dans sa bulle, encadrée et bientôt fixée dans son couloir, les deux mains écartées au sol en attendant l’ordre de s’élancer hors de son starting-block.
Elle arbore des ongles vernis d’un vert pastel qui défie faiblement le jaune explosif de la concurrente tchèque à sa gauche, c’est leur stratagème innocent pour capturer l’œil de la caméra ; la couleur ici proclame la confiance travaillée, conquise, arrachée au destin, implantée en soi car tout s’est joué à l’entraînement et la compétition n’est qu’une répétition, l’application d’une stratégie établie, enfouie comme un billet plié au fond d’une bouteille offerte aux vents, aux mouvements puissants de l’océan dans l’espoir d’une délivrance explosive. Sophie ne regarde que le bout de ses doigts, hypnose colorée avant l’apothéose, surtout ne pas s’occuper de la femme d’à côté, ignorer également la favorite au style harmonieux sacrée double championne du monde, rester totalement en soi et pour soi, aller chercher comme l’a répété le coach mille fois « Ce que tu es » et parfois Sophie entendait « Ce que tu haies » lorsqu’elle songeait à l’accumulation d’efforts, de souffrance et d’abnégation, autrement dit « Ce que tu hais ». Prête à bondir, elle garde maintenant la tête baissée, tout à fait immobile derrière le maigre rideau de ses cheveux assemblés par un élas- tique au sommet du crâne : rien ne doit venir effleurer son visage totalement dégagé, parfaitement nu comme dans l’attente d’un baiser.
— 25 —
QUI A DÉPLACÉ LE SEL ?
Kamel patine, il piétine, s’obstine, se défile, aux filles ne se fie, il s’isole, se camisole, se « mé-fille ». Ghita initie la dispute, l’argutie, elle discute, étire le fil, tire son fils, met les points sur les « i », le hisse, lui, son petit, son souci.
Je crois qu’elle a peur de moi…
De qui parles-tu, Kamel ?
Pas envie de te dire…
Alors ne dis rien !
Nadia, elle a peur de moi.
Comment le sais-tu ?
Je ne sais pas, elle ne veut pas aller plus loin que l’amitié.
Aucune fille ne te doit rien ; elles ne sont pas des objets disponibles sur un plateau, mais tu feras forcément une rencontre inattendue et belle, crois- moi !
Il n’y a personne.
Tu rigoles, il y a des filles qui…
Je ne veux pas parler de ça avec toi !
Moi non plus, de toute façon, je suis trop fatiguée.
— 26 —
Ghita a presque envie de hurler qu’elle travaille, qu’elle vient d’achever sa journée aux soins palliatifs, où des gens condamnés viennent mourir sans avoir à souffrir, à se tordre, à étouffer,
« Mais tu vois ça reste dur, ça reste la mort ! » Elle aimerait juste pouvoir se plonger dans la saison trois d’une série télévisée qui relate la vie d’une reine dans son époque, Élisabeth II en famille, une intimité en résonance avec le monde entier qui se déploie et affiche ses célébrités, ses intri- gues politiques, ses événements plus ou moins connus, disséqués et filmés comme si le passé ainsi rembobiné retrouvait une nouvelle jeunesse. Karim prépare des cocktails dans un bar des Champs-Élysées et ne rentrera pas avant trois heures du matin. « C’est trop bête, songe Ghita, je voulais lui demander de construire un bateau pour y transporter notre petite famille réduite à trois personnes. » Elle murmure « Com- me sur l’Arche de Noé » et regarde son fils à la dérobée.
Maman, tu parles toute seule ? C’est quoi ce charabia ?
Je pensais à un épisode de la Bible quand le patriarche bâtit une arche pour sauver du déluge ses proches et un couple de chaque espèce animale… Tu n’as pas besoin d’être sauvé, toi ?
Je m’en fous de la Bible, c’est le livre des Juifs !
Et pourtant on retrouve Noé dans le Coran…
Mais toi tu as bien parlé de la Bible, tu n’ai- mes pas ta religion, tu préfères celle des Juifs ?
— 27 —
Je m’intéresse un peu à ces différentes traditions et d’ailleurs ce mythe remonte aux Assyriens, alors… Je te rappelle que chez nous on ne vient pas avec des préjugés antisémites ! Tu ne voudrais pas qu’on laisse ce petit peuple tranquille ? Sans même parler du nazisme, tu sais que les Juifs ont été persécutés par les chrétiens pendant des siècles, et aujourd’hui on parle d’une histoire soi- disant judéo-chrétienne pour nier d’une autre manière la spécificité du judaïsme…
Ah, parce qu’Israël laisse les Palestiniens tranquilles ? Tu ignores que les Juifs pratiquent l’apartheid, bombardent des hôpitaux, tuent des enfants avec leur armée hyperpuissante ?
Bon, déjà Israël c’est un pays qui mène comme tous les pays une politique, dans un contexte particulier, très difficile pour les Palesti- niens, oui, mais pour les Israéliens aussi, et cette politique n’est pas celle de tous les Juifs du monde, sans oublier qu’il y a des Arabes israéliens qui ne souhaitent pas avoir une autre citoyenneté… alors s’il te plaît, tu cesses d’écouter les idiots qui nous bassinent depuis septante ans avec ce petit État qui a le droit d’être là où il a été créé, et tu descends jeter la poubelle, ça te fera sortir un peu !
Kamel ne bouge pas. Il déteste sa mère quand elle prend cette voix tranchante, de plus en plus souvent, d’ailleurs, et songe à la planter là pour rejoindre Karim, aller manger des tapas entre hommes ça serait bien, hélas il sait que son père ne pourra pas s’éclipser en plein travail. Ghita change de voix, adopte le ton de l’osmose, le son d’autre- fois.
— 28 —
Le sauvetage de Moïse a mobilisé quatre Juives et deux Égyptiennes, six femmes coura- geuses et résolues, alors tu vois, il faut travailler ensemble pour aller mieux, et pas cultiver cette haine entre les cultures et les religions. Tu entends ce que je dis ?
Oui, oui…
Kamel ne l’écoute pas, il se laisse seulement bercer par la douceur de cette voix maternelle. Ghita commence à éplucher les légumes et garde pour elle la suite de ses réflexions tandis que Kamel, momentanément apaisé, saisit la poubelle et sort de l’appartement. « Mais qui a déplacé le sel ? Il doit rester sur cette étagère, sinon je deviens folle. Mais oui, c’est moi, je perds la boule… Il faudra changer cette serviette, elle est sale, ma parole je fais tout ici ! Kamel m’inquiète tellement, sa manière de se livrer aux autres tel un désespéré, j’imagine la peur de Nadia, qui le connaît pourtant depuis l’enfance, il ne fait plus rire, mon Kamel, j’espère que les idiots ne l’ont pas retourné avec la providence divine offerte aux “ bons croyants ”, lui qui travaille déjà si peu va tout rater s’il attend la main invisible du ciel ! Naturellement, personne ne fait rien sans le soutien des autres, ce mensonge du self-made-man sert juste à tromper le fisc quand on a réussi, c’est le mythe du planqué, mais de là à se laisser complètement aller, moi j’aime bien l’idée du revenu de base inconditionnel et, à partir de là, chacun fait ce qu’il peut pour s’épanouir au mieux de ses possibilités, à la hauteur de ses ambitions… » Et puis notre société pourrait réserver certains emplois à ceux qui ne sont pas neurotypiques. C’est
— 29 —
un enfant sur cent ! Les malchanceux de la tombola ne font pas partie de la fameuse relève ? En Europe, ils sont privés du label « génération montante », mais les Américains ont compris que ces jeunes apportent aussi quelque chose. Je suis devenue athée le jour où j’ai découvert la dyslexie de Kamel. Les gènes sont horriblement sans gêne, et celui qu’on appelle « Dieu » ose vraiment tout ! Prends une leucémie, toi, et l’autre là, une schizophrénie, un autisme pour la route petit bonhomme à peine né, et toi, mignonne qui croques la vie, bipolaire ça te va ? Ton amygdale perd les pédales, mais tu ne vas pas te plaindre ? Ça bouscule tes émotions, tu es bombardée de stimuli sans savoir pourquoi, si ça continue tu vas passer pour une hystérique, tu seras mal-aimée, personne ne voudra se donner la peine de soulever cette barrière entre les cerveaux pour essayer de te comprendre, alors tu rentreras dans ta coquille, tu seras médicamentée à vie, mais il y a pire, n’est-ce pas ? Tu aurais pu venir au monde dans un trou perdu, un lieu où la maladie prend vraiment toute son ampleur tragique, sans aucun espoir possible ; tu as débarqué dans un pays riche, fillette, et toi Kamel, tu es français et tu surmonteras tes difficultés à condition de ne pas céder à n’importe quelle sirène…
— 30 —