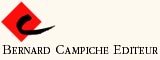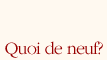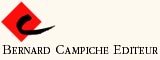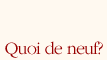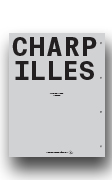Charpilles, Valentin et Sacha Decoppet
Recueil à part, Charpilles
détonne sur la scène littéraire et poétique romande. Que ce soit par
son engagement résolu dans des thèmes sociaux ou par l’originalité de
sa ligne graphique, le recueil se distingue immédiatement et promet une
lecture aussi étonnante que stimulante. Au-delà de l’objet, il s’agit
de saluer le travail littéraire. La découpe du vers est précise et les
jeux d’échos souvent riches: le lecteur est comme envahi par des voix
qui s’imposent et se répètent. De page en page, la multiplication des
inventions ne laisse jamais en repos, peut-être un effet, à la lecture,
digne de l’expérience de mobbing dénoncée dans le texte.
FONDATION C. F. RAMUZ
Chroniques Payot
• Coup de Coeur
Coup de Coeur
De temps en temps, très rarement, l’éditeur Bernard Campiche «s’offre»
de publier un beau livre: c’est ainsi qu’on a pu se glisser dans les
coulisses d’un spectacle amateur s’attaquant à Hamlet (Opération Shakespeare, hélas épuisé), suivre Jacques-Étienne Bovard dans sa passion, La Pêche à rôder,
ou découvrir les collections de photos de Charles-Henri Favrod,
fondateur et ancien directeur du Musée de l’Elysée. Mais depuis dix
ans, plus rien… Et soudain, Charpilles.
«Charpir» signifie «mettre en pièces»; dans certains parlers régionaux,
les charpilles sont les copeaux de bois produits par le rabotage. Rien
qui laisse augurer de bien valorisant lorsqu’il s’agit d’employés et
d’employeurs… Et, de fait, le romancier et traducteur Valentin Decoppet
(Les Déshérités) et son frère
Sacha, graphiste formé à l’ECAL, s’emparent à travers cet ouvrage
insolite et beau d’un thème banal et laid, le mobbing. Si le processus
managérial est connu, ses conséquences sur l’entreprise et, surtout,
sur les victimes sont beaucoup moins mis en évidence. Se faire mettre
au placard, personne n’a envie d’en faire état… Eux, si. Et pas en
catimini mais dans les grandes largeurs, avec un format imposant, un
graphisme original très travaillé, et une présentation audacieuse: des
feuillets libres perforés, prêts à classer. Classer les pages, dont
l’apparence évoque de simples documents administratifs, mais pas le
sujet, décortiqué avec un sens prononcé de la psychologie, de la
sociologie et de la dramaturgie. Captés à tous les niveaux de
l’entreprise, ces monologues aux tons divers, aux intentions variées,
aux sous-entendus audibles, composent un corpus inquiétant de réalisme
et de justesse, dont il serait bien étonnant qu’aucun comédien ne
s’empare pour un spectacle, qui donnerait une dimension supplémentaire
à la vitalité de Charpilles et au remarquable travail de ses deux
artisans.
JOËLLE BRACK, payot.ch
28 juillet 2025
Charpilles Valentin & Sacha Decoppet
«Il y a des textes qui ne devraient être que murmurés ou chuchotés.
D’autres qu’il faudrait pouvoir hurler ou marteler.» Georges Perec. Penser/Classer.
Charpilles est essentiel et finement politique.
Valentin & Sacha Decoppet sont deux frères qui, ici, rassemblent leurs talents fascinants.
Valentin est écrivain et éditeur. Sacha est graphiste.
Ce livre atypique d’un format souple, perforé de quatre trous sur le
côté droit de chacune des pages et de la couverture est un double
langage.
L’entrée même dans le monde du travail. On ressent un ouvrage en coopération et opératif.
Une archive sociétale en advenir.
Un document précieux et allégorique.
Doté d’un pouvoir créatif hors norme, original et bientôt universel.
Tant sa valeur humaine est un outil pour tous et toutes.
Charpilles, lire, grappiller, regarder, saisir, soutenir, retenir.
Avancer dans une cadence dactylographique.
Suivre les traits, les graphiques, les cercles, les pointillées, les flèches et les mesures.
Des charpilles irrécusables et nécessaires.
Des morceaux d’architecture, tels des coups de maillet sur nos consciences.
L’esthétique créatrice est une gageure, où chaque mot fait sens,
percute, et déclame un objet-livre engagé et crucial, douloureux et
véridique.
Il symbolise les gestuelles au travail. Les ralentis, les accélérations, les chutes et les doutes.
Les larmes et souffrances dans une ponctuation où les signes, les
renvois, les répétitions et litanies, le blanc insistant lourd de
silence, consignent le mobbing.
Le harcèlement moral, l’exclusion mentale, les relations conflictuelles, les tensions, les drames d’évitement.
Ce livre est mobile, vivant. Signifiant, il est ostensible et devient un manifeste sociologique majeur.
Un outil pour tous et le fronton indubitable d’une prise de conscience urgente.
«Puis fin du / congé / maternité / retour au / bureau mais / changement
de /bureau /ma remplaçante / m’a remplacée / je fais des cafés /des
verres d’eau puis /rien /rien /rien des /jours sans /rien / je suis
dans / un cagibi /mes chefs / m’oublient je / tourne en rond.»
«Pour calomnier il / faut un vrai / talent une /vraie /motivation / et
surtout / une oreille complice un /assentiment /silencieux qui
/autorise à /attaquer/sans arrêt / la même /personne /jusqu’à /tout
/détruire c’est /un travail /d’équipe un /travail de /sape.»
Charpilles, des miscellanées dévorantes d’authenticité.
Dans les épreuves où les hiérarchies, les prises de pouvoir, assignent
les oppressions, le non travail, celui qui, bridé par les soumissions,
les violences psychologiques et l’abus de pouvoir sont des poisons
lents et une mort à petit feu. Tel, le collègue qui fait de son
collègue, un bouc émissaire, son exutoire, le lâcher prise de ses
frustrations. La violence gratuite en quelque sorte.
Les litanies, les mots répétés, tels des hommes et des femmes piégés
par les diktats de racisme, de jalousie, de la suprématie masculine, le
machisme, les invisibilités, les mépris, les médisances, les faits de
mobbing à l’instar d’un boomerang reçu en plein visage.
L’obligation de silence, l’effacement, l’isoloir, les gestes déplacés,
les agressions sexuelles, les souffrances psychologiques, jusqu’à la
prononciation des pires sadismes.
Tout en nuances, en faux-semblants, la mesquinerie, le mobbing jusqu’au cœur d’une famille.
Ce livre est une mise en abîme absolument authentique. Que ce plaidoyer dépasse les non-dits, les peurs et les hontes.
D’utilité publique, familiale et personnelle, il devrait être déposé
dans tous les lieux où se glissent subrepticement, les fléaux qui
déshumanisent.
Ici, le panthéon qui cherche l’axe de la lumière.
Il n’a de cesse de combattre. Que « Charmilles » soit lu par
tous les DRH, les cols blancs, les employés (es), toi et lui, elle et
eux et moi, celles et ceux qui frôlent les murs, tant la peur
d’anéantissement, d’annihilation, d’expiration est immense.
«À la fin tu / abandonnes / parce que ça ne sert à / rien d’être / seul /dans une équipe.»
Blog d'EVLYNE LERAUT
Pour la compréhension de ce livre original, il convient au préalable de définir deux mots:
• Charpille: Copeau, résidu de bois du rabot.
• Mobbing: Harcèlement psychologique au travail.
Comme il est question de mobbing, le titre Charpilles évoque la mise en charpie psychologique dûn collaborateur.
Le livre est d'un format inhabituel: 31 cm x 24 cm (c'est pourquoi il
n'est pas facile de l'emporter avec soi... et que j'ai mis du temps à
m'y plonger).
Les frères Decoppet se sont répartis la tâche: les 45 textes sont de Valentin et la conception graphique de Sacha.
Pour le lire, il faut s'habituer à cette conception graphique: il faut
certes lire les textes de haut en bas, mais, suivant le texte, lire de
gauche à droite puis, parfois, de droite à gauche, parfois traverser de
la page de gauche à la page de droite.
Par ailleurs d'une double page, l'autre, les polices et tailles de
caractère changent, ce qui ne laisse pas d'avoir un effet...
psychologique sur le lecteur.
Enfin la répétition lancinante de certains mots ne peut manquer de frapper son esprit.
Le lecteur, s'il veut comprendre l'ouvrage, a intérêt à lire le mot-clé
de chaque double page, qui se trouve en marge, à gauche et à droite.
S'il est malin, il n'attendra pas d'aller au bout de sa lecture pour
aller à la page 101 où le nombre 45 est expliqué, qui éclaire la
construction de l'ouvrage:
«C’est en s'intéressant à plusieurs cas d'infirmières qui s'étaient
suicidées ou avaient tenté de le faire que le psychosociologue suédois
Heinz Lehmann (1932 -1999) développe le Lehmann Inventory of
Psychological Terror, une liste de 45 agissements constitutifs du
mobbing – ou harcèlement psychologique. Pour Lehmann, il suffit qu'un
des points de cette liste se produise au moins une fois par semaine
pendant environ 6 mois pour que l'on puisse parler d'une situation de
mobbing.»
Le lecteur ainsi averti comprendra alors pourquoi il est fait
allusion, de temps à autre, à Lehmann... dans les textes du livre.
Pour donner une idée du contenu, voici un extrait d'un des
quarante-cinq textes, qui ne respecte volontairement pas la conception
graphique du livre, difficile à reproduire, et introduit une
ponctuation, inexistante:
«La signature
- Je vous ai demandé plusieurs...
- plusieurs fois, plusieurs fois... Il faut arrêter de se chercher des
excuses. Si vous voulez ma signature, vous venez dans mon bureau. Vous
dites là: j'ai besoin de votre signature pour les autorisations, et
voilà. C'est pas sorcier. C'est pas plus compliqué que ça.
- C'est pas compliqué, mais...
- Mais. Pas de mais. Il faut vous secouer les puces. C'est pas une
manière de travailler. Si tout le monde faisait comme vous, vous vous
imaginez le merdier. Il faut vous secouer les puces, vous sortir les
pouces, mon petit.
- Oui mais.
- Pas de "oui mais", nom de Dieu ! Vous êtes bouché?
- Vous n'êtes jamais là.
- C'est le pompon ! C'est pas croyable ! C'est ma faute ! Vous n'aviez qu'à écrire un mail.
- Je vous ai écrit trois mails.
- Ah oui. Vous êtes sûr ? Je n'ai rien reçu.
- Je peux vous les renvoyer.
- Non. Mais c'est pas grave. Écoutez, passez-moi le papier. Je le
signe. Comme ça, c'est fait et vous avancez, parce que la semaine
prochaine je veux que ça soit réglé. Continuez à faire du bon travail.
D'accord ?
- D’accord.»
Ce texte est violent dans le fond, mais il l'est moins dans la forme.
Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains textes d'illustration, le
supérieur hiérarchique se permet d'être délibérément beaucoup plus
grossier...
Il permet de comprendre le but recherché par les auteurs - puissent-ils
être entendus par ceux qui se comportent mal avec leurs collaborateurs,
sans souci des conséquences:
«Nous ne voulons pas dénoncer, mais montrer, faire sentir la
destruction des personnes. Et avec un peu de chance faire changer les
choses. »
Blog de FRANCIS RICHARD
Haut de la page
Bourreaux du bureau: une cartographie du harcèlement
L’un est écrivain, l’autre
graphiste. Valentin et Sacha Decoppet détournent avec brio l’esthétique
bureaucratique pour signer un livre-objet qui décrit la violence du
mobbing. Original mais surtout éloquent
Il faudrait, pour honorer ce livre, l’effeuiller, en montrer le
spectacle des pages! On se contentera de le décrire, c’est le métier
après tout, et de dire à quel point ces Charpilles, inclassables bien
que perforées de quatre trous qui semblent les destiner à un classeur,
constituent l’ouvrage le plus original qu’il nous ait été donné de voir
depuis longtemps.
Publié par Bernard Campiche, qu’on ne soupçonnait pas de pareille
audace, c’est une rame de papier, schémas et colonnes de mots, comme
sortie de l’imprimante d’une quelconque administration. On s’en
approche: c’est une narration, une scansion, coulée dans une
pseudo-esthétique bureaucratique, au croisement de la to-do list
et du calligramme. Placé sous le signe de Bartelby, gratte-papier qui
dans la courte nouvelle de Melville répond un jour à son employeur
qu’il «préférerait ne pas», un récit se dessine, fragmentaire, pour
tenter d’approcher toute la sournoise complexité du harcèlement
professionnel. De page en page, chacune étant mise en scène avec une
inventivité graphique et narrative renouvelée, se dessine un vaste
panorama du mobbing, fondé sur la typologie établie au siècle passé par
le psychosociologue suédois Heinz Leymann.
«C’est en voyant les cas de mobbing se répéter autour de nous, voire
même augmenter, que mon frère et moi avons décidé de traiter ce sujet,
par l’écriture et le graphisme», note dans sa postface l’écrivain et
traducteur Valentin Decoppet, formé à l’Institut de Bienne, auteur en
2022 d’un polar qui nous avait semblé prometteur, et qui ici voit sa
prose mise en espace par le graphiste formé à l’ECAL Sacha Decoppet.
Entre prouesses typographiques et pulsation poétique, c’est un essai
d’Art faber, un manifeste ouvrier en col blanc, qui décrit la violence
du bureau comme A la ligne de
Joseph Pontus disait celle de l’usine; du secondaire au tertiaire, la
photocopieuse a remplacé la ligne de production, mais la souffrance est
la même, née de la répétition, de l’humiliation, de la déshumanisation.
Rares sont les ouvrages qui, comme La Couleur des choses
de Martin Panchaud a renouvelé l’esthétique de la BD en puisant dans
l’infographie, expérimentent de nouvelles formes avec à-propos, sans
jamais se détourner du fond. Ainsi de ces Charpilles,
livre-objet qui, avec brio, détournent les codes visuels du monde de
l’entreprise pour esquisser la cartographie de ses asservissements.
Alors pour tenter d’en montrer tout de même une page, on fait comme le
narrateur assigné au scanner – «poser le livre face contre verre et
fermer le couvercle lumière un mois à regarder la lumière un mois pour
apprendre à scanner page après page après ligne après ligne.»
THIERRY RABOUD, La Liberté
C’est
en voyant les cas de mobbing se répéter autour de nous, voire même
augmenter, que mon frère et moi avons décidé de traiter de ce sujet,
par l’écriture et le graphisme. En effet, si les langues commencent à
se délier, le sujet reste encore peu visible en littérature, et si
c’est le cas c’est souvent d’un point de vue personnel, particulier. Or
s’intéresser au mobbing, c’est commencer à reconnaître des modèles, des
points communs entre chaque situation. C’est se rendre compte qu’il y a
aussi un après-mobbing qui laisse des traces, des traces avec
lesquelles il faut vivre et parfois survivre. C’est observer que les
personnes qui mobbent ne répondront bien souvent jamais de leurs actes,
le mobbing étant difficile à prouver. C’est voir que la liste de
Leymann, si elle est un commencement, n’arrive pas à rendre compte de
la réalité du mobbing, de la détresse des personnes qui en sont
victimes. Charpilles est une tentative de mettre les mots sur les maux,
de visibiliser une maladie qui se répand, une maladie dont on pense
toujours qu’elle touchera les autres mais pas nous, jusqu’à ce que ça
nous arrive. Nous ne voulons pas dénoncer mais montrer, faire sentir la
destruction des personnes. Et avec un peu de chance faire changer les
choses. parente soumission ne l’empêcheront pas d’exercer sa liberté.
VALENTIN DECOPPET
|